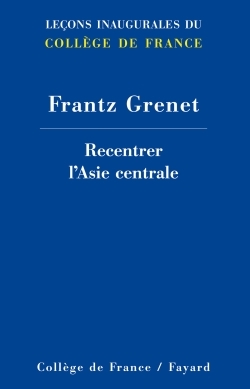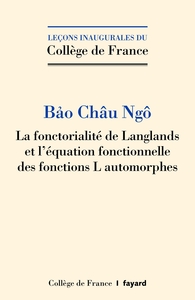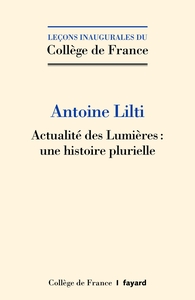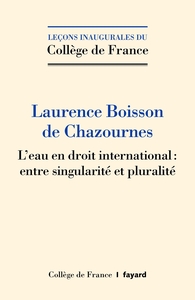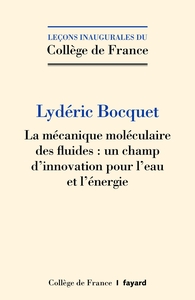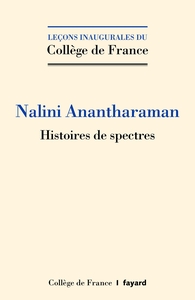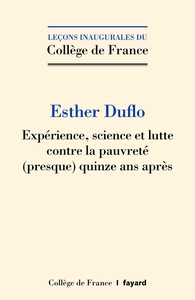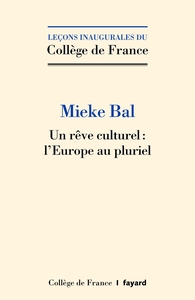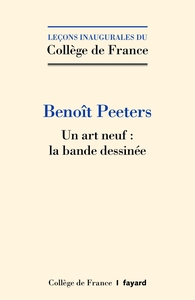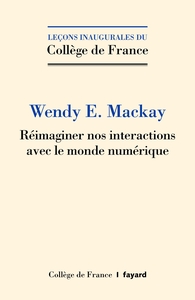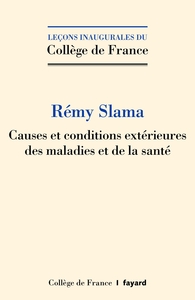Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
RECENTRER L'ASIE CENTRALE
Fayard - EAN : 9782213681436
Édition papier
EAN : 9782213681436
Paru le : 19 mars 2014
10,20 €
9,67 €
Epuisé
Arrêt définitif de commercialisation
Notre engagement qualité
-
 Livraison gratuite
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
 Manquants maintenus
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
 Un interlocuteur
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
 Toutes les licences
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
 Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
 Service client
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9782213681436
- Réf. éditeur : 8466649
- Collection : COLLEGE DE FRAN
- Editeur : Fayard
- Date Parution : 19 mars 2014
- Disponibilite : Epuisé
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 72
- Format : 0.50 x 12.00 x 18.50 cm
- Poids : 82gr
- Interdit de retour : Retour interdit
- Résumé : La notion d’Asie centrale a émergé tardivement dans la littérature géographique. C’est seulement à partir de 1825 qu’elle vient supplanter celle de « Tartarie », souvent associée à la terreur mongole et caractéristique d’une perception de l’Asie centrale comme foyer d’un péril prêt à fondre dans toutes les directions. Dans le même temps, la notion est à géométrie variable, même si depuis quelques décennies les archéologues s’accordent à englober sous ce terme les cinq républiques ex-soviétiques du Turkménistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan et du Kirghizistan et de l’Afghanistan. Le renouvellement des études sur l’Asie centrale est d’abord dû à l’archéologie qui s’est constituée dans le courant du XXe siècle, principalement autour de deux composantes qui ont maintenant assez largement fusionné sur le terrain : l’école française portée par la Délégation archéologique française en Afghanistan et l’école soviétique des grandes « expéditions » pluridisciplinaires. De nouvelles perspectives de recherche ont également émergé grâce à la redécouverte des deux langues principales de la région, le sogdien et le bactrien, avec dans chaque cas une masse importante de textes où est encore peu représentée la création littéraire, dont l’existence nous est surtout connue par les arts figuratifs. L’actualité de la recherche reste marquée par le caractère souvent imprévisible des découvertes, souvent effectuées en dehors des fouilles régulières.
- Biographie : Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, Frantz Grenet est agrégé d'histoire et docteur en archéologie. Membre de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) en résidence à Kaboul de 1977 à 1981, il a notamment participé aux fouilles archéologiques d'Aï Khanoum. Après sa thèse, il a été chercheur puis directeur de recherches au CNRS dans l'équipe AOROC/Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident. Depuis 1999, il est directeur d'études à l'EPHE (section des Sciences religieuses, chaire Religions du monde iranien ancien). Depuis sa création en 1989, il dirige la Mission archéologique franco-ouzbèke de Sogdiane (MAFOUZ), qui fouille notamment le site de l'ancienne Samarkand. Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il est professeur au Collège de France depuis mai 2013, titulaire de la chaire Histoire et culture de l'Asie centrale préislamique.