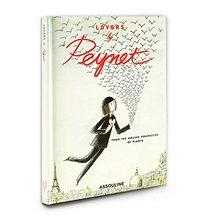Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Revue Savoir/Agir n° 61-62
Croquant - EAN : 9782365124126
Édition papier
EAN : 9782365124126
Paru le : 11 janv. 2024
10,00 €
9,48 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
 Livraison gratuite
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
 Manquants maintenus
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
 Un interlocuteur
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
 Toutes les licences
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
 Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
 Service client
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9782365124126
- Réf. éditeur : 978236512412
- Editeur : Croquant
- Date Parution : 11 janv. 2024
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 188
- Format : H:230 mm L:160 mm E:10 mm
- Poids : 289gr
- Résumé : Les travaux contemporains sur les classes sociales en Europe, mêlant étroitement objectivation de la structure sociale, sociologie de la culture et sociologie de l’éducation, ont suggéré la centralité des ressources cosmopolites dans la reproduction des inégalités sociales et dans l’exercice de la domination symbolique qui soutient les dominations économique et politique1. L’acquisition de ressources internationales apparaît aujourd’hui comme une source de légitimité décisive pour accéder à des positions de pouvoir à l’intérieur des frontières nationales et au-delà2.<br /> Pourtant, rares sont les travaux sociologiques contemporains en France qui objectivent finement le maniement de la langue anglaise, langue transnationale dominante et composante essentielle de ces ressources cosmopolites. L’anglais s’est en effet progressivement imposé comme langue mondiale, utilisée dans les échanges entre nationalités très différentes3. Dès l’accélération de sa diffusion en France au cours du dix-neuvième siècle, les formes de son apprentissage sont variées, hiérarchisées socialement et font l’objet de luttes4. Le faible niveau d’anglais supposé des Français, rengaine principalement portée par les réformateurs scolaires souhaitant adapter le système d’enseignement au marché du travail, alimente depuis plus d’un siècle et demi des débats récurrents sur son enseignement. Si cette déploration perdure, elle obscurcit plusieurs dynamiques historiques qui sous-tendent les évolutions des formes et des usages de l’anglais dans l’espace national : l’intensification des usages de l’anglais du fait de son statut de langue transnationale dominante, la réalité d’une distribution socialement très inégale de la maîtrise de cette langue, le déplacement du centre de gravité de l’espace social comme du système d’enseignement vers le pôle économique où les demandes de maîtrise de l’anglais sont vives, ou encore l’exacerbation de la concurrence scolaire et de la compétition entre grandes écoles, qui tendent elles aussi à accroître l’importance accordée à la maîtrise de cette langue. L’anglais et ses usages sociaux constituent donc un point d’entrée empirique fécond pour interroger les recompositions de l’espace social que produit la montée en puissance des ressources internationales dans les pratiques et les représentations nationales. <br /> Face au paradoxe de la centralité de ce fait social comme du caractère heuristique de cet objet sociologique, d’une part, et du peu de travaux qui s’y confrontent directement, d’autre part, nous avons cherché avec ce dossier à susciter et à réunir des productions qui interrogent les usages sociaux de l’anglais dans des univers variés. Nous avons pour cela « passé commande » à des sociologues dont nous imaginions que les enquêtes empiriques pouvaient avoir croisé la question de l’anglais sans forcément l’avoir traitée de front. Nombreux et nombreuses sont les sociologues qui nous ont répondu qu’en effet, la question n’avait pas été prise à bras le corps au moment de l’enquête ou dans l’écriture, même si, rétrospectivement, elle apparaissait bien comme un enjeu important des mondes sociaux qu’elles et ils avaient étudiés. Certain·es ont accepté de retravailler en ce sens leurs matériaux d’enquête pour ce numéro et nous espérons que le caractère fécond de cette démarche inspirera de nouvelles enquêtes afin de compléter l’esquisse que ce dossier propose.<br /><br /> Les usages sociaux de l’anglais<br /> L’historien néerlandais Willem Frijhoff propose de considérer l’usage d’une langue comme une pratique culturelle dans une société donnée5. Cela implique de définir la totalité des positions qu’une langue peut adopter dans le jeu social, c’est-à-dire l’ensemble des situations dans lesquelles la langue en question peut jouer un rôle signifiant, soit en tant qu’instrument de communication, soit en tant que symbole d’autres valeurs qui renvoient à l’histoire de cette langue ou à la position réelle ou présumée de celles et ceux qui la pratiquent. À rebours du sens commun qui ne voit dans le recours à une langue qu’une fonction véhiculaire (de communication), ce dossier insiste sur les fonctions conjointes de sélection sociale et de distinction que remplit la maîtrise de l’anglais. Enfin, les articles soulignent les visions du monde qui voyagent dans la soute de cette langue avec laquelle les agents sociaux font bien plus que « communiquer ».<br /><br /> La sélection par l’anglais<br /> Un premier usage de l’anglais se trouve dans la fonction de sélection qui lui est de plus en plus assignée, que ce soit à l’entrée des formations prestigieuses ou de certains secteurs professionnels : cet impératif est aujourd’hui assimilé par certaines familles. <br /> L’article de Marie-Pierre Pouly en début de dossier dresse un espace social de l’anglais, qui permet de comprendre où il est parlé en partant de la façon dont il est appris selon les fractions de classe. Ce sont dans les familles particulièrement dotées, d’abord en capital économique mais aussi en capital culturel, que les stratégies éducatives incluent largement l’apprentissage de l’anglais. L’étude de cas de Martine Court et Joël Laillier sur une famille de la bourgeoisie établie détaille ainsi la place socialement située de cette insistance sur l’apprentissage de la langue le plus tôt possible. Les stratégies de transmission précoce de l’anglais impliquent, pour ces familles, une variété de méthodes et une énergie considérable : consommation de produits culturels en anglais dès le plus jeune âge, voyages familiaux dans des pays anglophones, emploi de jeunes filles au pair, voire de nannies pour pratiquer l’anglais à domicile (ce que constate aussi Alizée Delpierre dans son article), scolarisation dans des écoles anglophones en France, voire expatriation dès l’enfance ou l’adolescence dans les pensionnats anglais, ou suisses, comme le souligne l’article de Caroline Bertron. Elle montre d’ailleurs que si les offres des écoles suisses étaient autant francophones qu’anglophones au début du vingtième siècle, elles sont aujourd’hui bien plus souvent anglophones en raison de la demande accrue des parents, actant la domination de l’anglais comme première langue internationale sur laquelle les familles portent leurs investissements économiques et temporels. Toutes ces stratégies d’apprentissage précoce, héritées de l’aristocratie, historiquement plutôt tournées vers l’anglais britannique, ont pour enjeu d’en faire une langue qui ne soit pas étrangère, dont le rendement scolaire soit pleinement efficace, notamment pour l’entrée dans les grandes écoles françaises, voire les établissements anglophones prestigieux et, in fine, dans les carrières professionnelles envisagées pour les enfants. Dans les classes supérieures, et notamment celles qui cumulent ressources économiques et culturelles, les compétences en anglais peuvent donc être particulièrement élevées avant l’entrée dans l’enseignement supérieur. <br /> Au niveau des formations, cause ou conséquence de cet investissement des familles aisées et de la concurrence que se livrent les institutions scolaires pour les capter, l’anglais se transforme en outil de sélection scolaire prétendument objectif. C’est déjà la thèse de Gilles Lazuech en 1996, dans son enquête portant sur 300 écoles de commerce et d’ingénieurs, où il montrait la place de la maîtrise linguistique dans la lutte que se livraient les grandes écoles qui, pour deux tiers d’entre elles, exigeaient un niveau minimal dans deux langues étrangères pour l’obtention du diplôme6. L’obligation linguistique s’accentuait encore dans les très grandes écoles : dans 40 % d’entre elles, plus de 30 % des élèves effectuaient un séjour académique. Dans les près de trente années qui nous séparent de cette enquête, cette internationalisation s’est encore accélérée et la proportion d’étudiant·es des grandes écoles faisant un séjour à l’étranger lié aux études (stage ou séjour académique) a fortement augmenté7.<br /> Cet impératif d’anglicisation des cursus a commencé dans les années 1960 par les écoles de commerce, comme le montre Anne-Catherine Wagner dans ce dossier, du fait de leur proximité avec les milieux d’affaires qui promeuvent depuis le dix-neuvième siècle des formes d’apprentissage « anti-scolaire » de la langue, encourageant des usages commerciaux et mondains. Les écoles d’ingénieurs étudiées par Adrien Delespierre s’y mettent à partir des années 1980, et les Instituts d’études politiques enquêtés par Ugo Lozach internationalisent leur cursus à partir des années 1990. Ugo Lozach souligne à quel point l’épreuve d’anglais est discriminante socialement, et montre à partir de données sur les candidat·es aux concours d’entrée dans les IEP que les indicateurs de possession d’un capital international les distinguent nettement de leur cohorte de lycéen·nes, ce qui vaut a fortiori pour les reçu·es au concours. L’anglicisation des cursus des IEP et des grandes écoles d’ingénieur témoigne des vocations désormais plus internationales de ces deux types d’écoles initialement tournées vers la production d’élites nationales. Adrien Delespierre éclaire ainsi la façon dont cette anglicisation s’inscrit dans un mouvement plus vaste de reconversion de la noblesse d’État qui se place désormais à la tête d’anciennes entreprises publiques qu’elle transforme à marche forcée en firmes de dimension mondiale. <br /> L’usage sélectif de l’anglais opère d’ailleurs sur les marchés du travail internationalisés pour recruter des travailleurs. La maîtrise de cette langue peut ainsi être lue par les employeurs comme un signal d’autres compétences socialement désirables, comme le montre Alizée Delpierre à propos du critère de la maîtrise de l’anglais dans les pratiques de recrutement des particuliers qui emploient des domestiques. À l’échelle individuelle, on voit comment la très forte ascension sociale de Paul, diplomate dont Marie-Pierre Pouly détaille la trajectoire dans la rubrique Paroles, s’appuie sur cette ressource linguistique encore relativement rare à l’époque de ses études en IEP au début des années 2000, et qu’il savait utile sur le marché du travail. Dans l’hôtellerie de luxe, où les employé·es doivent servir une clientèle de classes supérieures internationales, la pratique de l’anglais est nécessaire pour monter dans la hiérarchie des postes interactionnels comme l’expliquent Amélie Beaumont et Thibaut Menoux. Si un séjour de travail de plusieurs mois était auparavant nécessaire pour espérer une promotion, l’arrivée de profils plus diplômés, aux origines sociales plus hautes, et qui maîtrisent davantage l’anglais avant d’entrer en poste, est aujourd’hui souvent plus efficace pour obtenir les postes les plus convoités du secteur. L’exigence d’une maîtrise d’un anglais conversationnel codé entraîne alors une formalisation croissante de l’anglais du luxe hôtelier, qui renforce à son tour l’effet de sélection par la langue à l’entrée du secteur.<br /> De même que l’anglais n’est pas transmis dans toutes les familles, ou mis en avant dans toutes les formations, les univers professionnels où l’anglais est nécessaire pour communiquer et érigé comme barrière au recrutement ne sont pas situés aléatoirement dans l’espace social. On le trouve dans les secteurs des services, de la vente, et plus largement du commerce, où l’anglais s’est imposé comme la langue principale dès lors qu’il faut communiquer avec une clientèle internationale, comme pour le cas de l’hôtellerie de luxe. Dans certains espaces académiques, comme l’économie étudiée ici par Pierre Fray et Frédéric Lebaron, l’anglais s’est imposé comme la langue de travail principale, y compris en France. Il en va de même dans les entreprises très internationalisées, où les cadres communiquent en anglais (américain) ou alternent entre français et anglais avec aisance, ce dont rend compte ici Isabel Boni-Le Goff pour les cabinets de conseil. User de l’anglais pour sélectionner les travailleurs constitue ainsi un indicateur qui situe socialement, par l’international, les différents secteurs d’activités et les groupes sociaux qui y évoluent. <br /><br /> L’usage distinctif de l’anglais<br /> Au-delà des fonctions sélectives que remplissent les compétences en anglais, sa maîtrise à un excellent niveau opère également comme un signal distinctif, du fait de sa rareté d’abord, mais aussi par les pratiques et les imaginaires auxquelles elle est associée. La langue renvoie en effet à un ensemble de signes culturels distinctifs et vecteurs d’entre-soi. <br /> Les stratégies éducatives des familles dotées en capitaux n’ont ainsi pas que des avantages en termes de compétences linguistiques pour les compétitions scolaires et professionnelles. Elles sont aussi distinctives parce qu’elles s’inscrivent dans tout un style de vie. Au-delà de l’usage de la langue, ce sont en effet aussi les « choses anglaises » (habillement, manières d’être, sociabilités, etc.) qui sont désirées dans certaines familles bourgeoises8. Le style anglais, parce qu’il est prisé de longue date par la bourgeoisie établie ou l’aristocratie, peut être mobilisé dans l’espoir d’un ennoblissement partiel des fractions de classe économiques à mesure qu’elles s’établissent dans la bourgeoisie. Les articles du dossier éclairent ainsi, pour la période contemporaine, la différenciation sociale des usages de l’anglais en donnant à voir, en sus de l’apprentissage de la langue, la transmission de dispositions cosmopolites et d’un capital international (pratiques de mobilité, capital social et pratiques culturelles internationales). <br /> Comme le montre Caroline Bertron, le souhait de s’affilier aux élites internationalisées est au principe de l’inscription des enfants dans les pensionnats suisses anglophones, en sus de l’apprentissage de l’anglais, que certains enfants peinent d’ailleurs à apprendre : certaines conditions sociales de félicité doivent être réunies pour que l’incorporation linguistique opère. Le développement de sociabilités transnationales de même que l’acquisition de diplômes étrangers (notamment l’International Baccalaureate) ont vocation à servir de passeport pour la bourgeoisie cosmopolite. Les articles de Lorraine Bozouls, d’une part, et de Martine Court et Joël Laillier, d’autre part, soulignent la valeur symbolique des choses anglaises et de la langue anglaise dans la bourgeoisie établie : elles renvoient à une certaine conception du raffinement social, dans le logement, l’alimentation et l’habillement notamment. Revendiquer cette attirance et cette familiarité depuis la France permet ainsi de montrer que l’on maîtrise plus que la langue, en inclinant d’emblée les enfants à adopter un style de vie international dans son versant le plus distinctif, c’est-à-dire anglosaxon. S’assurer les services de domestiques ou d’employé·es du service hôtelier parlant anglais permet, de la même manière, de choisir du personnel socialement distinctif, comme le montre Alizée Delpierre. En retour, l’ascension professionnelle de ce personnel passe par une maîtrise linguistique qui peut d’ailleurs créer des aspirations à un style de vie international plus proche de celui de la clientèle, ce que repèrent Amélie Beaumont et Thibaut Menoux. <br /> Cette socialisation précoce à l’anglais dans la fraction internationalisée des familles des classes supérieures exerce ensuite des effets dans les cours d’anglais. Les articles d’Anne-Catherine Wagner sur les MBA, d’Ugo Lozach sur les IEP, et d’Adrien Delespierre sur les écoles d’ingénieurs soulignent de façon remarquablement convergente la position très ambivalente des enseignements d’anglais dans ces formes scolaires. Ils sont souvent dévalorisés par les étudiant·es malgré l’importance accordée à l’internationalisation, tandis que les enseignant·es d’anglais sont jugé·es principalement à l’aune de leur accent et de leur qualité linguistique : un nombre croissant d’étudiant·es très tôt socialisé·es à la langue anglaise la juge finalement inférieure à la leur, dévalorisant dans ce mouvement à la fois les enseignant·es et leurs cours. <br /> Au-delà de la maîtrise de la langue, la distinction par l’anglais joue encore dans les mobilités permises par les écoles auxquelles appartiennent les étudiant·es. Un simple séjour dans un pays anglophone n’est plus à lui seul distinctif : c’est le prestige de l’institution où il est effectué qui apparaît décisif. L’obtention de partenariats avec ces institutions anglophones, notamment celles de l’Ivy League et d’« Oxbridge », constituent alors un autre aspect de la compétition entre grandes écoles, comme le montre Adrien Delespierre9. Pour être pleinement efficace, la compétence linguistique doit en effet être associée à d’autres ressources. En esquissant un espace de l’internationalisation de l’enseignement secondaire et supérieur, le dossier souligne bien le rôle que jouent l’offre et la demande de formes scolaires internationalisées distinctives dans les recompositions contemporaines des écarts symboliques entre les groupes sociaux.<br /> L’article de Pierre Fray et Frédéric Lebaron, par une étude de cas portant sur l’économie, permet de réfléchir à l’accumulation symbolique distinctive permise par le recours à la langue transnationale dominante (l’anglais). Ils montrent que l’imposition du monolinguisme anglophone au sein de l’économie comme discipline scientifique et comme formation de l’enseignement supérieur s’apparente à une révolution symbolique. Les compétences en anglais de quelques économistes initialement marginaux leur permettent des mobilités professionnelles aux États-Unis dans les années 1950 qui les intègrent aux débats et aux manières étatsuniennes de faire science. Cette ressource linguistique et scientifique distinctive permet progressivement, à cette génération mais surtout à celle qu’elle forme, d’imposer en France ces nouvelles manières de penser la discipline et transforment durablement le champ de l’économie. Le pôle dominant au sein de l’économie est aujourd’hui doté d’un capital scientifique10 international dont l’accumulation et l’universalisation reposent sur une combinaison linguistique particulière : celle du langage mathématique et de la langue anglaise.<br /> Ce panorama des usages distinctifs de l’anglais met en évidence ce que peut véhiculer la maîtrise d’une langue quand elle est utilisée dans des groupes sociaux qui y sont sensibles, en intensifiant la rentabilité des capitaux détenus. Ces effets multiplicateurs apparaissent d’autant mieux grâce aux deux derniers articles du numéro, qui offrent des contrepoints particulièrement éclairants. Frédéric Rasera et Manuel Schotté montrent ainsi que l’anglais n’est pas un prérequis aux carrières internationales des joueurs de football : c’est la langue nationale de chaque club qui prévaut dans les échanges quotidiens, et cela malgré la multiplicité des nationalités en présence. Cette règle amène les joueurs aux carrières internationales à apprendre des langues variées (allemand, espagnol, italien, etc.) au gré de leurs placements. Mais, du fait du stigmate social associé à ces jeunes hommes principalement issus de milieux populaires (et souvent racisés) et de la moindre valeur sociale des autres langues maîtrisées, ces savoirs linguistiques bien réels sont disqualifiés. Alexis Ogor montre quant à lui, à partir d’une enquête sur les étudiant·es inscrit·es en licence d’arabe à l’Inalco, que les usages sociaux de cette langue rarement enseignée et négativement connotée en France sont bien plus ambivalents et surtout bien plus difficilement reconvertibles en profits symboliques et économiques que dans le cas de l’anglais. La maîtrise de l’arabe dialectal (parlé), celui utilisé par la plupart des arabophones en France, n’est pas rentable dans le système d’enseignement valorisant une langue classique ou standard (écrite). Il distingue alors deux usages de la langue arabe (qui diffèrent de ceux de la langue anglaise), qui correspondent à deux types de trajectoires : d’un côté, des enfants d’ascendance arabophone utilisent l’apprentissage de l’arabe pour renouer avec leur « culture d’origine », tandis que des enfants issus des classes supérieures sans lien préalable avec la langue, voient dans l’arabe un outil pour accéder à des postes dans les relations internationales. Ce sont ces étudiant·es les plus doté·es socialement, in fine, qui ont le plus de chances de faire fructifier la maîtrise de la langue arabe en la traduisant en position sociale. Ainsi, ces contrepoints au dossier incitent à ouvrir des chantiers sur les autres langues que l’anglais et invitent à toujours spécifier les profits afférents aux usages des langues selon les contextes et les propriétés sociales des locuteurs et locutrices.<br /><br /> L’anglais porteur d’une vision du monde économique et politique<br /> De façon inconsciente ou revendiquée, l’usage de l’anglais dans des contextes sociaux singuliers véhicule des visions du monde, loin d’être neutres socialement et politiquement. Des conceptions professionnelles, économiques, éducatives, politiques, des manières de converser ou de conceptualiser les débats accompagnent les usages de l’anglais du fait des filières par lesquelles la langue est importée, au sein des familles, des formations ou des mondes professionnels. Les travaux empiriques réunis dans ce dossier mettent notamment en évidence l’association fréquente de la langue anglaise à la valorisation capitaliste des échanges commerciaux et de l’esprit d’entreprise, au détriment du point de vue des travailleurs, et son affiliation privilégiée à des conceptions politiques libérales des sociétés anglo-saxonnes.<br /> La longue association historique de l’anglais au commerce avec la Grande-Bretagne puis de façon croissante à partir de la fin du dix-neuvième siècle avec les États-Unis, qui teintent la langue anglo-américaine des valeurs du « self-made man » et de l’entreprise, son statut central pour les négociants de l’époque moderne puis dans le monde commercial contemporain, expliquent la forte affinité contemporaine de l’anglais (notamment de l’anglais américain) et de l’ethos commercial. On en trouve des traces dans l’article d’Isabel Boni-Le Goff, qui décortique les multiples significations que revêtent les emprunts lexicaux à la langue anglaise dans l’univers du consulting où elle constate, d’une façon générale, comment la langue anglaise est valorisée en ce qu’elle renvoie au sérieux entrepreneurial11. Les consultant·es ont ainsi recours au franglish quotidiennement, à la fois comme preuve de l’expertise des professionnel·les face à leurs client·es et comme langage d’initié·es dans les coulisses de la production de cette expertise. La langue véhicule ce faisant une manière d’envisager les rapports sociaux, le recours à l’anglais permettant souvent d’euphémiser la violence de certaines pratiques managériales comme les plans de licenciement, en les mettant à distance par le voile d’une langue seconde. La vision spécifique des affaires portée par l’anglais dans les écoles de commerce par lesquels beaucoup de consultant·es sont passé·es n’y est sans doute pas pour rien. Anne-Catherine Wagner souligne ainsi dans son article sur les MBA que l’agency theory et la philosophie néolibérale de l’école de Chicago se diffusent dans les écoles de commerce par le biais des sciences de gestion, légitimées par des instances de consécration savantes internationales où l’anglais domine sans partage. Dans leur article sur l’usage de l’anglais chez les économistes, Pierre Fray et Frédéric Lebaron montrent, dans une veine proche, qu’un ensemble de manières de faire ou de penser transite dans la soute de ce monolinguisme : par exemple, la mathématisation et le recours à l’anglais, comme linguae francae, entraînent une standardisation de l’espace des problèmes économiques et des normes d’écriture qui favorisent un désencastrement des faits économiques par rapport aux configurations sociales.<br /> Ce sont aussi des conceptions politiques qui sont importées avec la langue anglaise. Rachel Vanneuville a montré combien le modèle de la gentry anglaise a inspiré les classes dominantes françaises à la recherche d’un nouveau modèle libéral de concorde sociale après la Commune12 : la référence anglaise est décisive dans la conception de l’École libre des sciences politiques, ancêtre des Instituts d’études politiques. Ugo Lozach indique, pour la période actuelle, que le type d’anglais et les domaines d’expertise aujourd’hui nécessaires pour réussir le concours de Science Po, à savoir l’anglais journalistique du Guardian et du New York Times et l’actualité politique du Royaume-Uni et des États-Unis, charrient des points de vue politiques sur le monde qui sont ignorés comme tels. L’article de Lorraine Bozouls, pour sa part, témoigne de la prégnance de la valorisation, par les familles du pôle privé auprès de qui elle enquête, des représentations – qualifiées d’anglo-saxonnes – sur l’éducation, l’économie ou la politique, ce qui révèle une affinité éthique pour le modèle libéral dont les sociétés étatsunienne ou britannique sont perçues comme des exemples aboutis.<br /><br /> Comment qualifier la ressource que constitue l’anglais?<br /> Sans trancher, le dossier fournit des éléments pour enrichir la réflexion sur la façon de désigner la ressource que constitue la langue anglaise. Faut-il parler de capital international, de capital culturel, de composante cosmopolite du capital culturel, de coefficient international ou de formes internationalisées des capitaux ? <br /> Pour qualifier ce type de capital plus souvent accumulé par les fractions économiques, on peut réfléchir en termes de « capital international », comme le propose notamment Anne-Catherine Wagner13. Depuis une vingtaine d’années, les langues transnationales (et particulièrement l’anglais) sont présentes explicitement ou en filigrane dans un certain nombre de travaux autour des usages des biens internationaux, de la scolarisation ou de la transmission d’un capital international. Le terme de capital international désigne alors un ensemble de relations sociales internationales, de ressources, de titres et de compétences (linguistiques notamment), que l’on peut trouver sous ses trois « états » dans différents groupes sociaux.<br /> La forte association de la valorisation de l’anglais au pôle économique de l’espace social fait en effet hésiter à utiliser le terme de capital culturel ; néanmoins, la langue anglaise est bien transmise comme forme du capital culturel à la fois incorporé et institutionnalisé (c’est-à-dire intégré à une forme scolaire), même si la définition y compris scolaire de l’anglais garde la trace des luttes menées par les fractions économiques pour façonner le système d’enseignement à leur avantage, comme le rappelle Marie-Pierre Pouly dans ce dossier. Vaut-il mieux alors parler de « composante cosmopolite du capital culturel », suivant l’exhortation d’Érik Neveu à ne pas « marcotter » les capitaux14 ? <br /> Travailler aujourd’hui sur les dispositions cosmopolites et particulièrement les dispositions linguistiques transnationales contribue en tout cas aux discussions contemporaines sur les recompositions du capital culturel. La période actuelle est caractérisée par la diminution du poids des emplois publics et la professionnalisation du système d’enseignement, au sein duquel les hiérarchies se redessinent, comme, en parallèle, se transforme le marché du travail. On peut, de ce fait, émettre l’hypothèse que la façon dont le système d’enseignement parvenait à imposer et reproduire une culture légitime classique se transforme et donc que le capital culturel (ce qui fait capital d’un point de vue culturel et ce qui est certifié par les institutions culturelles/scolaires) se recompose. Le capital culturel classique (lettré) devient moins rentable et moins facilement convertible en position sociale tandis qu’apparaissent de nouvelles formes du capital culturel, plus rentables scolairement : les ressources linguistiques en font partie, de même qu’une forme culturelle s’appuyant sur l’informatique et les technologies de la communication. Ces nouvelles formes de capital culturel déclassent la culture humaniste ou littéraire classique, même si cette dernière peut continuer à être utilisée, du fait de son ésotérisme, pour établir des barrières scolaires, en apprenant le latin ou l’allemand par exemple15. <br /> Le cosmopolitisme culturel d’une fraction des élites s’oppose d’un côté à la mobilité forcée des migrant·es des pays pauvres (bras masculins de l’appareil de production industriel ou femmes aux affects exploités et dos cassés de la global care chain16) dont les ressources linguistiques, à l’instar de celles des footballeurs étudiés dans ce dossier par Frédéric Rasera et Manuel Schotté, ne font pas capital. Ce cosmopolitisme des classes supérieures s’oppose aussi, d’un autre côté, à la défiance d’une fraction des classes populaires envers ce cosmopolitisme17 et au goût d’autres fractions intermédiaires pour les langues qui peuvent être utilisées dans des stratégies d’ascension et dont les classes dominantes peuvent tenter de se distinguer. Ces oppositions sociales et culturelles se retraduisent alors dans un champ politique également clivé par la question du rapport au national ou à l’international. Comme le rappellent de façon nécessaire les travaux de Cédric Hugrée, Étienne Pénissat et Alexis Spire, c’est dans les milieux populaires, à l’échelle de l’Europe, que la présence des étrangers est la plus élevée. « À la différence des classes supérieures, pourtant si promptes à mettre en avant la mobilité transnationale et la tolérance aux autres, les classes populaires sont dans les faits beaucoup plus métissées et mélangées que tous les autres groupes sociaux », mais la mise en concurrence sur le marché du travail explique cette défiance, de même que la distinction culturelle, et donc la violence symbolique, que les formes culturellement légitimes du cosmopolitisme et la maîtrise des langues transnationales dominantes véhiculent18.<br /> Finalement, la dimension internationale opère comme un coefficient symbolique positif – quand il s’agit de langues et nations dominantes – facilitant la monétisation des capitaux culturels, économiques, sociaux et symboliques et leur accumulation, ou comme un coefficient négatif – attaché aux langues de nations dominées ou à l’absence de maîtrise des langues transnationales – susceptible de dévaluer les capitaux ou faire obstacle à leur accumulation19.<br /><br /> Conclusion<br /> Matière scolaire et universitaire, pratique linguistique incorporée, mais aussi langue associée, par les groupes qui la pratiquent ou la valorisent, à un style de vie et à une vision du monde, l’anglais contribue à la (re)production des écarts entre les groupes sociaux et à la recomposition des formes de domination. Ce faisant, à travers l’association de ces formes internationalisées de capital (social, culturel, symbolique) à des modèles d’organisation économique et politique et aux transformations du capitalisme, c’est in fine tout un ordre symbolique et les mécanismes de son imposition que les articles étudient, en proposant des études de cas centrées tour à tour sur les styles de vie et les styles éducatifs des familles, sur le système d’enseignement, le champ scientifique et divers univers professionnels.