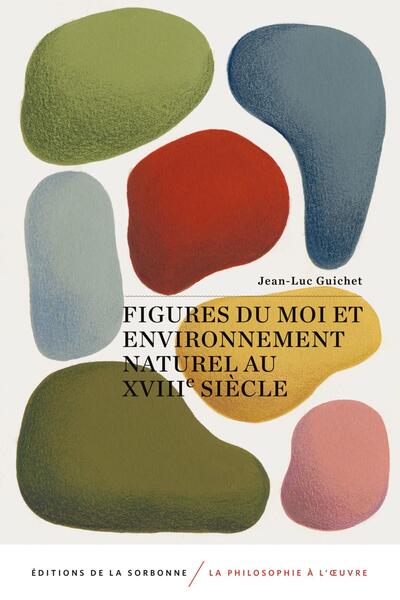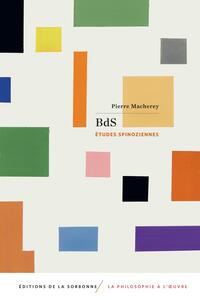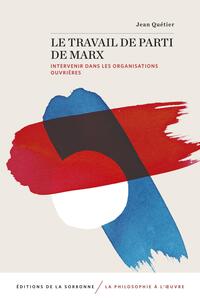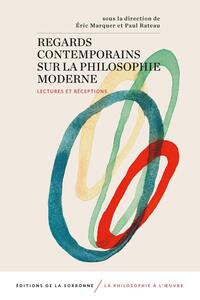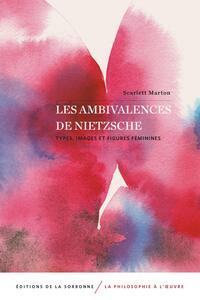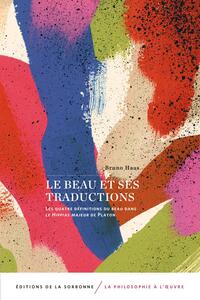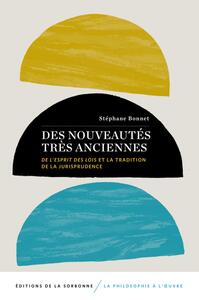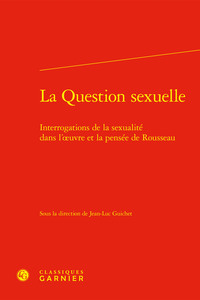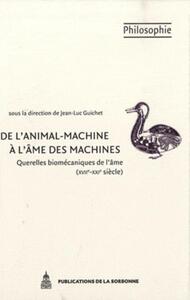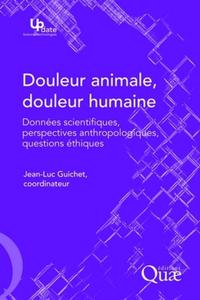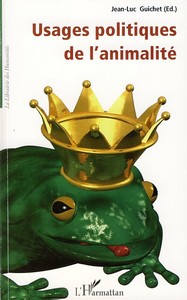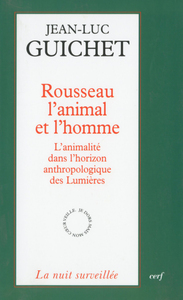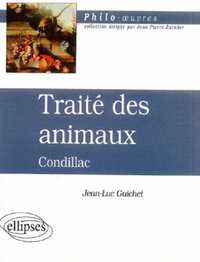Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la vie privée, nous devons demander votre consentement à l’utilisation de ces cookies. En savoir plus.
Figures du moi et environnement naturel au 18e siècle
Ed Sorbonne - EAN : 9791035105921
Édition papier
EAN : 9791035105921
Paru le : 22 oct. 2020
19,00 €
18,01 €
Disponible
Pour connaître votre prix et commander, identifiez-vous
Notre engagement qualité
-
 Livraison gratuite
Livraison gratuite
en France sans minimum
de commande -
 Manquants maintenus
Manquants maintenus
en commande
automatiquement -
 Un interlocuteur
Un interlocuteur
unique pour toutes
vos commandes -
 Toutes les licences
Toutes les licences
numériques du marché
au tarif éditeur -
 Assistance téléphonique
Assistance téléphonique
personalisée sur le
numérique -
 Service client
Service client
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
- EAN13 : 9791035105921
- Réf. éditeur : 123213
- Collection : LA PHILOSOPHIE
- Editeur : Ed Sorbonne
- Date Parution : 22 oct. 2020
- Disponibilite : Disponible
- Barème de remise : NS
- Nombre de pages : 206
- Format : H:240 mm L:160 mm E:15 mm
- Poids : 392gr
- Résumé : Cet ouvrage se propose d'étudier conjointement deux notions fondamentales des Lumières qui connaissent chacune une véritable promotion au XVIIIe siècle : d'une part, le moi et, d'autre part, la nature proche, en rapport vécu avec l'homme, c'est-à-dire ce que l'on a désigné depuis par le terme « environnement ». Si ces deux notions ont déjà fait l'objet d'études, celles-ci les ont souvent liées à d'autres thématiques – le sujet ou l'individu, par exemple –, ou bien quasi systématiquement reportées sur celles de la nature, du « sentiment de la nature » ou de la généalogie de l'écologie pour l'environnement, et, surtout, sans que ces approches prennent particulièrement en compte leur lien mutuel. Or, l'idée directrice de ce travail est que la définition du moi au XVIIIe siècle passe précisément par le rapport à l'environnement. Au sortir du siècle précédent, le moi, dépouillé de son armature interne par la critique des idées d'âme et de substance, semble comme orphelin et en quête d'une matrice dans laquelle penser sa formation et son devenir, et cela sur un mode désormais non essentialiste. C'est alors en se projetant dans des types de rapport qu'il pourra produire de nouveaux modèles d'intelligibilité de lui-même, participant ainsi indirectement de la genèse de l'anthropologie en cours : que ce soit celui du moi fragile, exposé aux déterminismes extérieurs et foncièrement incertain de lui-même ; celui du moi cadré, respectueux d'un ordre fixé par une volonté surplombante qui est souvent – mais pas toujours – celle de Dieu lui-même ; celui du moi fort, maître d'une nature à administrer et de climats à transformer (mais qui connaît aussi d'autres formes moins typiques et plus prometteuses) ; celui enfin du moi saturé, débordé par une capacité d'émotion qui s'exprime et se projette à travers l'extériorité naturelle. Ces différentes figures – qui se croisent et se combinent chez Locke, Hume, Condillac, Dubos, Montesquieu, Volney, Linné, Diderot, Buffon, Marivaux, Prévost, Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, auxquels il faudrait ajouter encore quelques autres noms –, loin de constituer des types rigides et séparés, sont autant de visages du même moi multiple, le moi de la modernité, celui qui est peu ou prou toujours le nôtre. Cette reconfiguration fondamentale opérée au XVIIIe siècle, nouant le destin du moi à celui de son environnement, installe un terrain de sensibilité qui permettra, aux siècles suivants, malgré tous les obstacles, retards et difficultés, la réception de l'écologie scientifique, puis politique et enfin éthique aujourd'hui, horizon irréductible à une simple nécessité extérieure et fonctionnelle.